Se rendre à Échiré depuis Paris
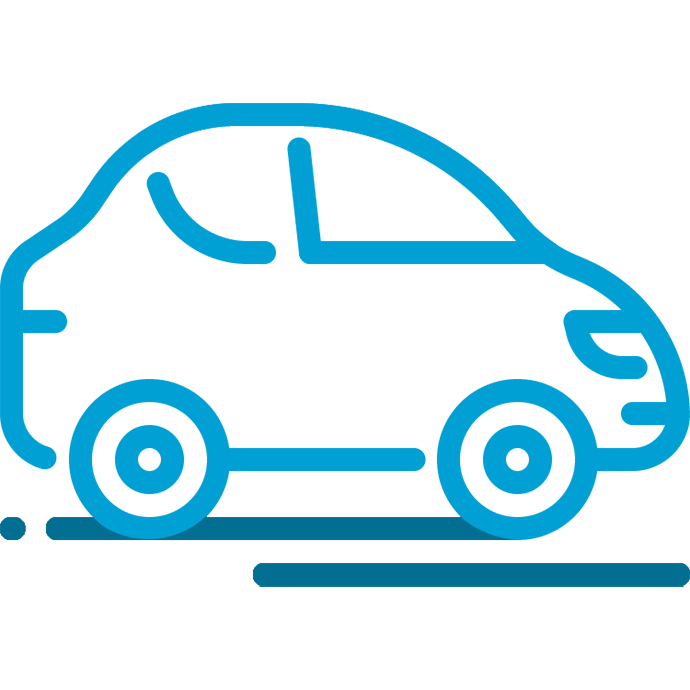
4H20
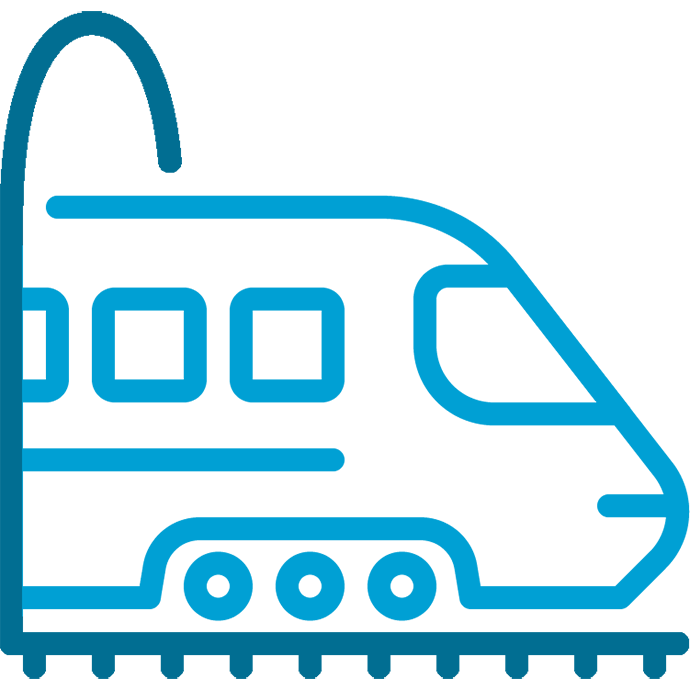
3H00

430 km
Le Château du Coudray-Salbart : Un Géant de Pierre au Cœur de l’Histoire
Imagine un instant un colosse de pierre, majestueux et silencieux, qui a traversé les siècles, témoin de luttes acharnées, de gloire éphémère et d’un long abandon avant de renaître. C’est l’histoire fascinante du Château du Coudray-Salbart, une forteresse médiévale d’exception nichée dans les Deux-Sèvres. Cet édifice, véritable livre ouvert sur l’architecture militaire du Moyen Âge, nous livre peu à peu ses secrets grâce au travail passionné d’historiens, d’archéologues et de bénévoles. Partons ensemble à la découverte de ce joyau architectural, incarnation des enjeux de pouvoir entre Plantagenêts et Capétiens.
Une Histoire Mouvementée au Fil des Conflits Anglo-Français
L’histoire du Coudray-Salbart est indissociable des grandes rivalités qui ont marqué le Moyen Âge. Elle débute véritablement au XIIe siècle, lorsque les puissants seigneurs de Parthenay-Larchevêque en deviennent les maîtres. Mais le destin du Poitou et, par conséquent, de ses forteresses, bascule avec les alliances royales. En 1152, le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt, qui deviendra roi d’Angleterre en 1154, fait passer toute la région sous la domination anglaise.
ts de l’histoire de France. Sa découverte est une véritable immersion dans le passé, où chaque pierre semble murmurer les récits des chevaliers et des sièges. Es-tu prêt à continuer ton voyage à travers ces forteresses médiévales ?
Construit dans la première moitié du XIIIe siècle, le Coudray-Salbart se retrouve alors au cœur des tensions et des affrontements incessants entre les rois Capétiens de France et les Plantagenêt d’Angleterre. Ses bâtisseurs, les seigneurs Hugues Ier et Guillaume V de Parthenay-Larchevêque, financent cette imposante construction grâce aux subsides reçus de figures royales anglaises comme Jean sans Terre (entre 1202 et 1203) et Henri III (en 1227). Ces fonds attestent de l’importance stratégique que les Anglais accordaient à cette forteresse, pensée comme un verrou défensif.
Le château connaît ensuite une longue période de déclin et des changements de propriétaires. En 1415, sous les tourmentes de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, Jean II de Parthenay est accusé de félonie. Déchu de ses droits, il perd ses baronnies, dont le Coudray-Salbart, qui est alors confié au Duc de Guyenne, puis au célèbre Arthur de Bretagne, Comte de Richemont (futur connétable de France). À la mort de ce dernier en 1458, la forteresse revient à l’illustre Jean Dunois, le « Bâtard d’Orléans », compagnon d’armes légendaire de Jeanne d’Arc.
Malgré ces noms prestigieux, le château est pratiquement abandonné. Les siècles passent, et en 1776, il passe aux mains du Comte d’Artois, qui deviendra plus tard le roi Charles X. Ce dernier le vend finalement à l’abbé Du Fay de la Taillée. Plus récemment, un geste symbolique et fort marque un nouveau chapitre : le Comte Pierre du Dresnay de la Taillée, descendant de l’abbé, cède le château pour le franc symbolique en juin 2000 à la Communauté d’Agglomération de Niort. Ce don généreux a permis d’assurer la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel pour les générations futures.
Explorer les Trésors Architecturaux de la Forteresse
Aujourd’hui, le Château fort du Coudray-Salbart, bien que partiellement en ruines, continue de fasciner et de livrer ses mystères. L’association des Amis du Coudray-Salbart, en étroite collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Niortais (son propriétaire actuel) et une équipe de chercheurs, mène un travail patient et passionnant. Ils mettent au jour quotidiennement de nouveaux indices, permettant de mieux cerner les différentes étapes de construction de cet édifice. C’est un véritable défi archéologique, car, fait surprenant, il n’existe pas de documents précis sur sa fondation, hormis une « prisée » (sorte d’inventaire) datée de 1460, soit plus de deux siècles après le début présumé de sa construction. Le château se dévoile ainsi pierre par pierre, couche après couche.
En vous approchant, la première chose qui vous frappera, c’est son impressionnant système défensif. Le château est entouré de quatre fossés secs, une ingéniosité militaire redoutable. Le premier ceinture l’ensemble, et sa profondeur et sa largeur varient considérablement, atteignant jusqu’à 20 mètres de large et 12 mètres de profondeur sur le côté est. Un pont-levis, malheureusement disparu aujourd’hui, permettait l’accès au « boulevard », une sorte de barbacane qui renforçait la première ligne de défense. Un deuxième fossé, également franchi par un pont-levis, sépare la basse-cour de la haute-cour. Un troisième, désormais intérieur, correspond aux vestiges du fossé du château primitif. Enfin, un quatrième fossé, situé à l’est au-delà du premier, était stratégiquement placé pour interdire toute avance de machines de guerre, telles que les trébuchets ou les béliers.
L’entrée de la basse-cour était autrefois une véritable forteresse miniature, défendue par la barbacane et un portail d’entrée majestueux, flanqué de deux tours robustes. La basse-cour elle-même, bien que ses bâtiments soient aujourd’hui disparus, abritait des éléments essentiels à la vie du château : murs d’enceinte, écuries, forges, et même une chapelle – il n’en reste malheureusement que quelques monticules témoignant de leur emplacement. Les murailles qui encadrent le pont-levis sont percées de six fentes de tir cruciformes, offrant aux défenseurs une visée optimale. Deux poternes, ces petites portes discrètes, permettaient des sorties dérobées : l’une au nord, au fond du fossé, et l’autre, plus surprenante, au sud, perchée et nécessitant une échelle pour y accéder, preuve de l’ingéniosité des concepteurs.
La Tour du Portal, qui tire son nom de l’ancien français « porte, portail », protégeait l’entrée principale avec son assommoir. À l’époque, l’escalier menant aux ponts était en pierre, avec des marches adaptées au pas des chevaux. Au rez-de-chaussée, vous accédez d’un côté à une remise et de l’autre à un escalier menant à une salle carrée couverte d’une voûte en berceau brisé. Cette salle, austère mais fonctionnelle, était meublée d’une cheminée, de latrines et présente une reconstitution plausible du treuil de levage du pont-levis, nous permettant d’imaginer la manœuvre.
En accédant à la Haute Cour, vous remarquerez les vestiges émouvants du château primitif, tels que des tours et pans de murs, ainsi que le fossé désormais intérieur, rappelant l’évolution du site. Autour de cette cour, une nouvelle enceinte a été développée et renforcée de six tours circulaires dans la première moitié du XIIIe siècle. Cette muraille était particulièrement innovante pour l’époque grâce à sa « gaine », un couloir intérieur qui permettait aux soldats de circuler à l’abri des tirs ennemis, assurant une défense continue et efficace.
Chacune des tours de cette forteresse possède son propre caractère et ses particularités architecturales :
- La Tour du Moulin : Bien que les origines de son nom soient incertaines (peut-être liée à la présence de moulins à proximité), cette tour abrite deux salles carrées couvertes de voûtes sur croisée d’ogives, ornées de chapiteaux sculptés. Chacune comporte trois grandes niches d’archères, défendant stratégiquement la Sèvre Niortaise toute proche. Ses particularités résident dans le chapiteau de l’angle Sud-Ouest du rez-de-chaussée, où est sculpté un personnage tenant deux dagues croisées au-dessus de sa tête, ainsi que le 1er étage orné de quatre chapiteaux (culs de lampe) sculptés de visages humains expressifs. Le sommet, crénelé à l’époque, est une terrasse dallée en trois pans inclinés, conçue pour évacuer l’eau de pluie via trois goulottes de pierre, un détail fonctionnel souvent oublié.
- La Grosse Tour : Cette tour massive, véritable archétype du donjon de l’époque, était le point culminant et le refuge ultime du château. Elle possédait des caractéristiques défensives essentielles, telles qu’une porte d’entrée surélevée (seul et unique point d’accès), et un profil en amande (« tour à bec »), partagé avec la tour Double, qui permettait de dévier les projectiles ennemis. Avec son diamètre impressionnant de 16 mètres au sol, elle s’élève à plus de 30 mètres au-dessus du fossé. Sa salle intérieure est d’une taille remarquable, couverte d’une voûte en croisée d’ogives liernées, dont la clé de voûte culmine à près de 12 mètres. Des têtes finement sculptées se distinguent au sommet des arcs formerets, celle au-dessus de la cheminée semblant représenter un dignitaire ecclésiastique. Éclairée par une baie géminée et dotée d’une grande cheminée, de deux coffres en pierre et de la seule latrine disposant d’une porte, elle était probablement prolongée au sommet par une salle recouverte de tuiles.
- La Tour Saint-Michel : La légende voudrait qu’un autel dédié à Saint-Michel ait donné son nom à cette tour. Son rez-de-chaussée date du château primitif et est traversé par la gaine. Il possède une voûte en coupole percée d’une large ouverture circulaire (oculus) au sommet. Cet oculus était loin d’être un simple puits de lumière : il permettait aux défenseurs de la forteresse de lancer toutes sortes d’objets (pierres, eau bouillante, etc.) sur les assaillants se trouvant en dessous. La salle du 1er étage possède une voûte en arc de cloître et deux archères, dont l’une fut bouchée lors de l’extension du château vers le nord. Comme d’autres tours, elle était probablement surmontée d’une salle recouverte de tuiles.
- La Tour Double : Cette tour doit son nom au fait qu’elle a été renforcée sur les deux tiers de sa hauteur par une maçonnerie supplémentaire, accentuant son profil en amande (« tour à bec »). Son diamètre initial a été agrandi, donnant cet aspect « double » caractéristique. Sa salle du rez-de-chaussée est spectaculaire, conservant sa surface initiale avec une voûte curieuse et quatre niches d’archère prolongées, offrant une défense optimale. Un escalier à vis mène à la salle supérieure, puis à la plateforme sommitale, offrant une vue imprenable sur les environs.
- La Tour Bois-Berthier : Cette tour a été ainsi nommée car elle se positionne non loin et dans la direction du lieu-dit « Bois-Berthier », un petit hameau où résidait probablement un seigneur à l’époque. Le rez-de-chaussée est une salle carrée avec une voûte spécifique aux Plantagenêt, qui étaient alors les propriétaires du château. On y trouve une cheminée, une latrine et trois niches d’archères. En montant l’escalier, restauré avec soin, on arrive à une salle octogonale au premier étage, couverte d’une curieuse voûte à huit quartiers rayonnants, une merveille de raffinement étonnante pour une forteresse militaire. Ce premier étage possède également une baie géminée et quatre profondes niches dont l’usage reste encore mystérieux pour les chercheurs. Bien qu’on ait découvert au sommet les traces d’une salle carrée couverte ultérieurement, il semble que la tour était à l’origine ornée de créneaux entourant une terrasse, offrant une position de guet stratégique.
Le Château du Coudray-Salbart est un site d’exception, un témoignage vivant et palpable de l’architecture militaire médiévale et des grands bouleversement













